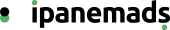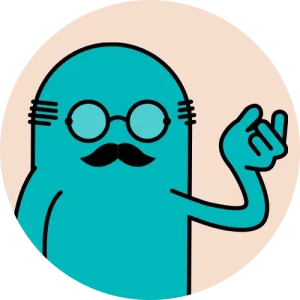La médecine entre dans l’ère de la Big Data. Les LLM et les systèmes experts analysent aujourd’hui des millions de documents en quelques secondes. La double promesse est là : accélérer le travail clinique et diminuer les erreurs. Le but, avoir le meilleur diagnostic médical. Mais un grand défi demeure.
Comment préserver la subtilité et le raisonnement humain face à ces outils ?
Comment l’IA peut-elle aider au diagnostic en accompagnant le raisonnement clinique du médecin ?
Exemple typique : le médecin contre l'IA
Une étude est parue dans le New England Journal of Medicine le 9 octobre 2025. Elle oppose un médecin chevronné, le Dr Gurpreet Dhaliwal, à un modèle IA, Dr CaBot, sur un cas clinique difficile.
L’histoire : un homme de 36 ans avec fièvre, infection à streptococcus anginosus, thrombose veineuse et opacités pulmonaires. Le Dr Dhaliwal établit une chaîne causale à partir d’indices disparates et soupçonne un corps étranger, un cure-dents, d’être à l’origine d’une perforation duodénale.

En quelques minutes, Dr CaBot génère un diagnostic différentiel médical très complet, mais ne mentionne pas cette piste essentielle. Trois jours plus tard, l’imagerie confirme la présence du cure-dent, qui sera retiré par endoscopie.
Cet exemple illustre bien la complémentarité : l’IA est forte pour l’exhaustivité et la rapidité, l’humain pour l’intuition de connecter des éléments inattendus.
Chiffres et corpus historique : les atouts des modèles IA
D’autres chiffres viennent appuyer ce constat. Une étude massive parue récemment en preprint sur arXiv (15 sept 2025) a constitué CPC-Bench, une base de 7 100 cas cliniques du NEJM entre 1923 et 2025. Sur un sous-ensemble uniquement textuel, Dr CaBot obtient d’excellents résultats : succès pour le diagnostic principal dans 60 % des cas (top-1) et dans 84 % des dix premières hypothèses (top-10).
Mieux, le modèle présente une forte capacité à prescrire des examens complémentaires (98 %). Ces résultats vont au-delà de l’exercice classique de la pose d’un diagnostic final.
Concurrence, positionnement et l'expérience ipanemads
Chez ipanemads, nous aidons les hôpitaux et les cliniques à intégrer ces assistants IA dans le flux clinique quotidien.
Concrètement, on crée des pipelines de modèles de langage, d’outils d’analyse d’images et d’interfaces interactives pour aider le clinicien. L’IA établit un diagnostic différentiel rapide, suggère des examens complémentaires appropriés et justifie le raisonnement
Mais attention, on le répète : la décision finale est humaine. Le clinicien reste responsable et le centre de la décision thérapeutique
Forces et limites techniques à connaître
De mon expérience, l’IA excelle sur la synthèse textuelle et la mémoire documentaire de masse. Elle repère des co-occurrences rares et émet des hypothèses peu connues.
Mais elle échoue à la récupération bibliographique précise et à l’interprétation d’images isolées, sans contexte.
Un diagnostic médical solide repose donc sur une interface qui force la validation humaine et qui favorise l’ajout d’informations tacites, celles qui ne sont pas dans les dossiers patients.
Perspective : vers une collaboration homme-machine transparente
Je vois demain les équipes cliniques travailler en permanence avec des « boucles » d’IA. Ces aides automatiseront la recherche bibliographique, proposeront des examens pour lever le doute, voire simuleront des scénarios causaux à partir des données cliniques.
Par exemple, l’IA pourrait :
- suggérer des hypothèses alternatives ;
- simuler l’effet d’un examen complémentaire sur la probabilité d’un diagnostic ;
- aider à la communication et à la documentation du raisonnement.
Des benchmarks publics tels que CPC-Bench vont aussi être essentiels pour normaliser l’évaluation des modèles et accélérer la sécurisation de cette nouvelle phase de la médecine.
Comme le notent les auteurs des études récentes, « les grands modèles rivalisent maintenant avec les humains dans le raisonnement clinique à partir de texte » (NEJM, arXiv).
Convergence et responsabilité
En bref, l’IA révolutionne le diagnostic médical : rapidité, exhaustivité. Mais l’intuition clinique reste irremplaçable pour reconstituer une chaîne causale, pour intégrer une expérience globale et pour prendre des décisions adaptées au contexte individuel du patient.
Pour moi, la meilleure approche est hybride : utiliser l’IA pour tester rapidement un grand nombre d’hypothèses, puis laisser le clinicien valider, affiner et trancher.
Les outils doivent être pensés comme des boucles de travail qui « respirent » avec les soignants, et non comme des substituts.